Temps de lecture : 9 minutes.
Comme on a déjà pu le voir dans ce précédent article consacré au concours, la France incarne (ou a incarné) le modèle de fonction publique de carrière. À l’inverse, plusieurs pays sont identifiés comme des fonctions publiques de métier : l’Italie, les Pays-Bas, les États-Unis.
Ce système de carrière se présente généralement par la conjugaison de plusieurs spécificités :
- Un accès par concours, et non par recrutement direct1 et
- L’intégration dans un corps (ou plus généralement un cadre hiérarchisé) lui donnant accès à des emplois et où le fonctionnaire a vocation à passer toute sa vie professionnelle en franchissant divers grades. Autrement dit : « la distinction du grade et de l’emploi. »
La Distinction du Grade et de l’Emploi
Un Principe Ancien, Né sous la Restauration
Cette distinction est née en France par la célèbre loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers2 qui dispose en son article premier3 que :
« Le grade est conféré par le Roi, il constitue l’état de l’officier ».

Son exposé des motifs est également célèbre et synthétise le système de carrière :
« Elle est fondée sur ces principes : que le grade constitue l’état de l’officier ; qu’il ne peut lui être arbitrairement enlevé, mais qu’il faut distinguer le grade de l’emploi ; qu’au Roi appartient le droit de donner l’emploi ou de l’ôter ; que, sans cela, la discipline et la subordination seraient détruites ; mais, si l’emploi et tous les avantages qu’il procure avaient pu être arbitrairement enlevés, on conçoit que le grade laissé à l’officier n’eut été qu’un vain titre ; en conséquence, des garanties sont données pour prévenir tout retrait arbitraire de l’emploi, et ces garanties sont d’autant plus grandes, que la position dans laquelle l’officier privé d’emploi se trouve placé se rapproche plus de la privation complète du grade. »
Un Principe À la Fois Souple et Sécurisant
La séparation du grade et de l’emploi implique, très concrètement, deux choses :
- Une protection pour le fonctionnaire (ou militaire) : la suppression de l’emploi n’emporte pas la suppression du traitement, du grade ou du droit à avancement4 ;
- Un instrument de gestion pour l’administration, qui est « maîtresse de l’emploi »5 : elle peut nommer, muter, affecter ou supprimer un emploi dès lors que l’intérêt du service le justifie.
Juridiquement, dans la fonction publique, seul compte : « l’intérêt du service ». Aucun frein, contractuel ou collectif6, ne s’impose à l’administration et aux chefs de service pour organiser le service7.
Ce mécanisme rend également possible une valorisation des emplois, puisque l’administrateur peut tout à fait définir des conditions spécifiques pour accéder à tel ou tel emploi.
Dans les Faits : Une Gestion Peu Orientée Vers l’Emploi
Une Pratique Parfois Rigide et Peu Orientée vers l’Emploi
En dépit de la souplesse offerte par le statut de la fonction publique et le principe de distinction du grade et de l’emploi, la pratique est parfois jugée rigide et « égalitariste », au détriment des emplois :
- Une notation administrative sans beaucoup d’effet sur l’évolution professionnelle ou les rémunérations ;
- Des concours centrés sur la sélection des candidats sur des compétences générales, sans logique de postes à pourvoir8 ;
- Une rémunération trop indexée sur le grade et l’échelon, au détriment des fonctions exercées9 ;
- Des mutations souvent guidées par l’ancienneté ou le grade, plus que par les compétences ou les besoins du service. La situation des enseignants est évidemment symptomatique, mais elle n’est pas unique10.
Les Aménagements Progressifs du Système de Carrière
Une Construction Doctrinaire au Fil de Rapports Consacrés à la Fonction Publique

Plusieurs rapports consacrés à notre système de fonction publique ont esquissé des propositions d’évolution vers une logique de métiers :
Le livre blanc sur l’avenir de la fonction publique du 17 avril 2008, dit rapport Silicani, qui formule quarante propositions, dont :
- la professionnalisation du recours aux contractuels,
- la facilitation des transitions professionnelles entre secteurs privés et publics,
- la reconnaissance d’accords collectifs,
- l’identification des métiers et la prévision de leur évolution qualitative et quantitative,
- l’identification des viviers de recrutement,
- la modernisation de l’organisation générale des recrutements,
- la professionnalisation des modes de recrutement par concours externes,
- la création d’un véritable marché de l’emploi public,
- l’affectation de chaque agent dans le cadre d’une convention établie entre lui et son employeur,
- la transformation de l’évaluation en un élément central d’évolution de la carrière,
- le renforcement de la sélectivité des promotions de grade,
- la distinction dans les rémunérations entre une composante liée au grade et une autre liée à l’emploi,
- la personnalisation de la rémunération fonctionnelle en tenant compte de la difficulté du poste et des résultats de l’agent,
- le développement des formations, notamment aux moments clés de la carrière.
Le rapport au premier Ministre sur la fonction publique du 4 novembre 2013, dit rapport Pêcheur, qui propose :
- le développement des démarches de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,
- la création de « statuts d’emplois communs » aux trois fonctions publiques et aux militaires,
- la relance des fusions de corps et la création de nouveaux « cadres professionnels interministériels »,
- la création de lignes directrices de gestion et le développement des affectations sur profils,
- la caractérisation des corps ou cadre d’emploi par le « niveau de fonctions » et non par le seul niveau de diplôme,
- le développement des échelons fonctionnels au sein des corps (accès à des fonctions élevées),
- ainsi que des mesures concrètes comme :
- la création d’une bourse commune de l’emploi public
- l’obligation de déclarer et de publier les postes vacants
- la construction d’un répertoire commun des emplois.
Le rapport de restitution des travaux de la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique du 14 mars 2022, dit rapport Peny, Simonpoli, qui réaffirme l’intérêt de la distinction du grade et de l’emploi et du système de grille de rémunération, mais propose en contrepartie :
- une plus grande prise en compte du niveau de qualification réel et du niveau de responsabilité ;
- une meilleure valorisation des compétences et des parcours des agents, notamment par la création d’accélérateur de carrière ;
- la création de filières, qui pourraient être communes à plusieurs versants de la fonction publique ;
- la reconnaissance d’une performance collective.
Ces idées ont désormais germées et ont profondément changé le système de gestion des agents publics.
Un Renforcement de la Logique de Métiers
Depuis plusieurs années, une logique de suppression et mutualisation de corps est à l’œuvre afin d’identifier les synergies et de valoriser l’aspect « métier »11.
Le nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État est passé de 700 en 2005 à un objectif de 270 en 2023.
Force est de constater que de nombreux corps avaient perdu le lien avec leur savoir-faire et leur justification initiale. Le corps est devenu un instrument de gestion et un sujet d’identification collectif, sans réflexion sur le métier lui-même.
Fusionner des corps, c’est donc aussi se séparer de certains symboles12, afin de « réactiver la dimension professionnelle de la carrière »13, tout en permettant davantage de fluidité et une plus grande richesse de carrière.
Une Plus Grande Interministérialisation
Cette fusion de corps va de pair avec une plus grande interministérialisation, que l’on peut notamment constater dans la forte augmentation des recrutements d’attachés d’administration de l’État. Elle s’est aussi incarnée récemment par la suppression de corps très symboliques : celui des préfets, des diplomates et des inspecteurs généraux (des finances, de l’administration, des affaires sociales…).
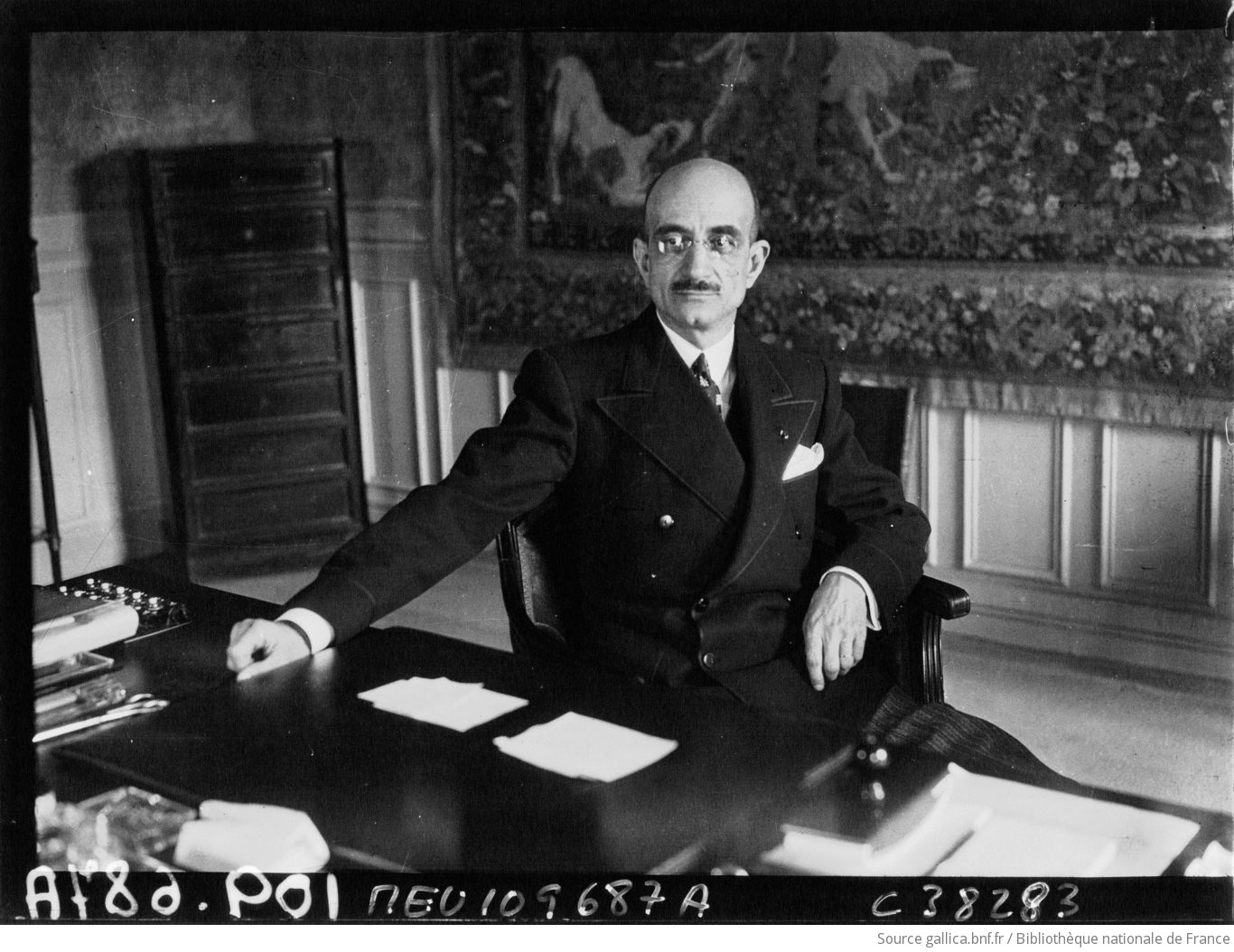
Elle facilite les mobilités entre les agents publics14, et ce faisant, décloisonne ces anciens corps en permettant de recruter en fonction de critères plus professionnels et pour des durées plus courtes.
L’étape suivante, notamment proposée dans les rapports Silicani ou Peny serait de substituer ces 270 corps par quelques filières : sécurité, administration générale…
Cette filiérisation et ce découpage par métier existe déjà par ailleurs :
Une structuration des emplois, parallèle à celle des corps de fonctionnaires, a déjà été mis en œuvre : il s’agit du répertoire des métiers de la fonction publique ;
Le site de publication des offres d’emploi des trois versants de la fonction publique (État, collectivités territoriales et hospitalières), choisirleservicepublic.gouv.fr, est déjà assis sur ces 29 filières et près d’un millier de métiers.
Le Renforcement de la Contractualisation
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (dite loi « TFP ») a largement libéré l’usage du contrat :
- Par l’ouverture des emplois de direction des trois versants de la fonction publique aux contractuels15 ;
- Par la création de contrats de projet, permettant d’embaucher des agents pour réussir des projets ou des opérations identifiées16 ;
- Par la possibilité pour l’intégralité des établissements publics de l’État de recruter des contractuels (contre quelques-uns limitativement énumérés auparavant) ;
- Par la possibilité pour les administrations de l’État de recruter des contractuels sur la majorité des emplois permanents17 ;
- Par une extension des possibilités de portabilité du contrat à durée indéterminée de l’agent public aux trois versants de la fonction publique18.
Désormais, comme aux débuts de France télécom ou de La Poste, les fonctionnaires cohabitent quotidiennement dans les administrations avec les contractuels19.
Cette contractualisation s’exerce également dans la gestion collective, à travers les lignes directrices de gestion ministérielle (introduite par la loi « TFP » de 2019), mais également les accords interministériels en matière de condition de travail20 et de protection sociale des agents publics21.
Ce mouvement semble inéluctable et très probablement salutaire. Comme le souligne MArcel Pochard, ancien directeur général de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) :
« Il est paradoxal de prétendre faire de la gestion personnalisée, sans l’outil qu’est le contrat. »
- Même si des exceptions existent, comme les nominations (très encadrées) au « tour extérieur », ou les pratiques de détachement pour les fonctionnaires, leur permettant des mobilités entre corps. ↩
- La loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers est consultable ici : https://books.google.fr/books?id=0dk1AQAAIAAJ&dq=loi%201834%20officiers&pg=PA105#v=onepage&q=loi%201834%20officiers&f=false ↩
- Quand l’article trois énonce ensuite les différentes positions de l’officier : activité, disponibilité, puis « non-activité » aux articles quatre et suivants. ↩
- Le fonctionnaire ne peut être révoqué par une sanction disciplinaire (article L. 533-1 du code général de la fonction publique – il s’agit d’une sanction du troisième groupe) ou par une loi de dégagement des cadres, dont les dernières intervenues sont liées à la Seconde Guerre mondiale. ↩
- Expression de Marcel Pochard, « L’emploi dans la gestion des ressources humaines de la fonction publique », Revue française d’administration publique 2009/4 (n° 132), p. 689-700.
DOI 10.3917/rfap.132.0689 ↩
- Les organisations syndicales n’ont pas, juridiquement, à se prononcer sur l’organisation du service. ↩
- Les différentes réformes territoriales de l’État auraient été difficilement possibles au même coût dans un système contractuel. Cette façon de gérer les effectifs, même si elle est commode pour l’employeur, peut toutefois poser des difficultés dans un contexte où les agents manifestent davantage d’attentes. Une plus grande personnalisation dans la gestion des agents est probablement nécessaire. ↩
- Ce qui est le principe du système de carrière, où la polyvalence prime ; mais qui dans un univers de plus en plus technique et complexe peut induire un manque de profondeur sur certaines fonctions. ↩
- Ce que l’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au côté du Complément indemnitaire annuel (CIA) tentent de corriger. Mais le régime d’IFSE n’est pas applicable partout, comme on l’a vu récemment dans un rapport consacré à la DGCCRF. ↩
- Voir également l’article issu du rapport de la Cour des comptes sur les corps techniques des ministères économiques et financiers. ↩
- Sur le modèle des « cadres d’emplois » des collectivités territoriales. ↩
- La suppression des corps de hauts fonctionnaires est topique. ↩
- Gilles Jeannot, « De la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) aux cadres statutaires : la progressive émergence de la notion de « métier » dans la fonction publique d’Etat en France », Revue française d’administration publique 2005/4 (no116), p. 595-608. DOI 10.3917/rfap.116.0595 ↩
- Désormais, l’administrateur de l’État peut ainsi, passer d’une fonction de préfet à diplomate, avant de devenir inspecteur général. ↩
- Près de 3 000 emplois de direction sont concernés. Ces emplois sont listés au décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 pour la fonction publique d’État. ↩
- Sans beaucoup de succès selon la Cour des comptes. Le dispositif est encadré par le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique. ↩
- Le (feu) article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoyait deux dérogations au recrutement de fonctionnaires : « 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes » et « 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’État à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du services le justifient. » La loi de transformation de la fonction publique élargi les cas prévus aux 2° en citant d’emblée « lorsque la nature des fonctions ou les besoins de services le justifient » et en disposant ensuite une liste indicative : « des compétences techniques spécialisées ou nouvelles », « lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée », enfin « 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires ». ↩
- Auparavant, cette portabilités n’était possible qu’au sein d’un des trois versants. En précisant toutefois que cette portabilité n’est pas un droit, mais une possibilité pour l’employeur. Il n’y a pas de « droit au CDI ». Et cette portabilité n’entraîne pas davantage la conservation des stipulations contractuelles. ↩
- À l’exception de quelques secteurs préservés, notamment dans les métiers de la sécurité. ↩
- Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021. ↩
- Avec en premier lieu l’accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l’État du 26 janvier 2022. ↩

Laisser un commentaire