Temps de lecture : 5 minutes.
Tout le monde n’a pas vocation à écrire une thèse1. Toutefois, le contenu méthodologique fixé dans les différents guides en la matière2 me semble particulièrement utile pour celui qui veut étayer ses argumentations.
À l’évidence, voilà des qualités utiles pour qui cherche à lire, prendre des notes et mobiliser celles-ci pour des travaux… notamment dans le cadre d’un concours ou examen professionnel.
Voici donc quelques éléments glanés dans l’ouvrage d’Henri Capitant, l’un des grands juristes (de droit privé) du début du XXe siècle3 et père de René Capitant, juriste également et plusieurs fois ministre4.
Pour ceux intéressés, l’ouvrage est disponible sur Gallica et a été réédité en version papier.
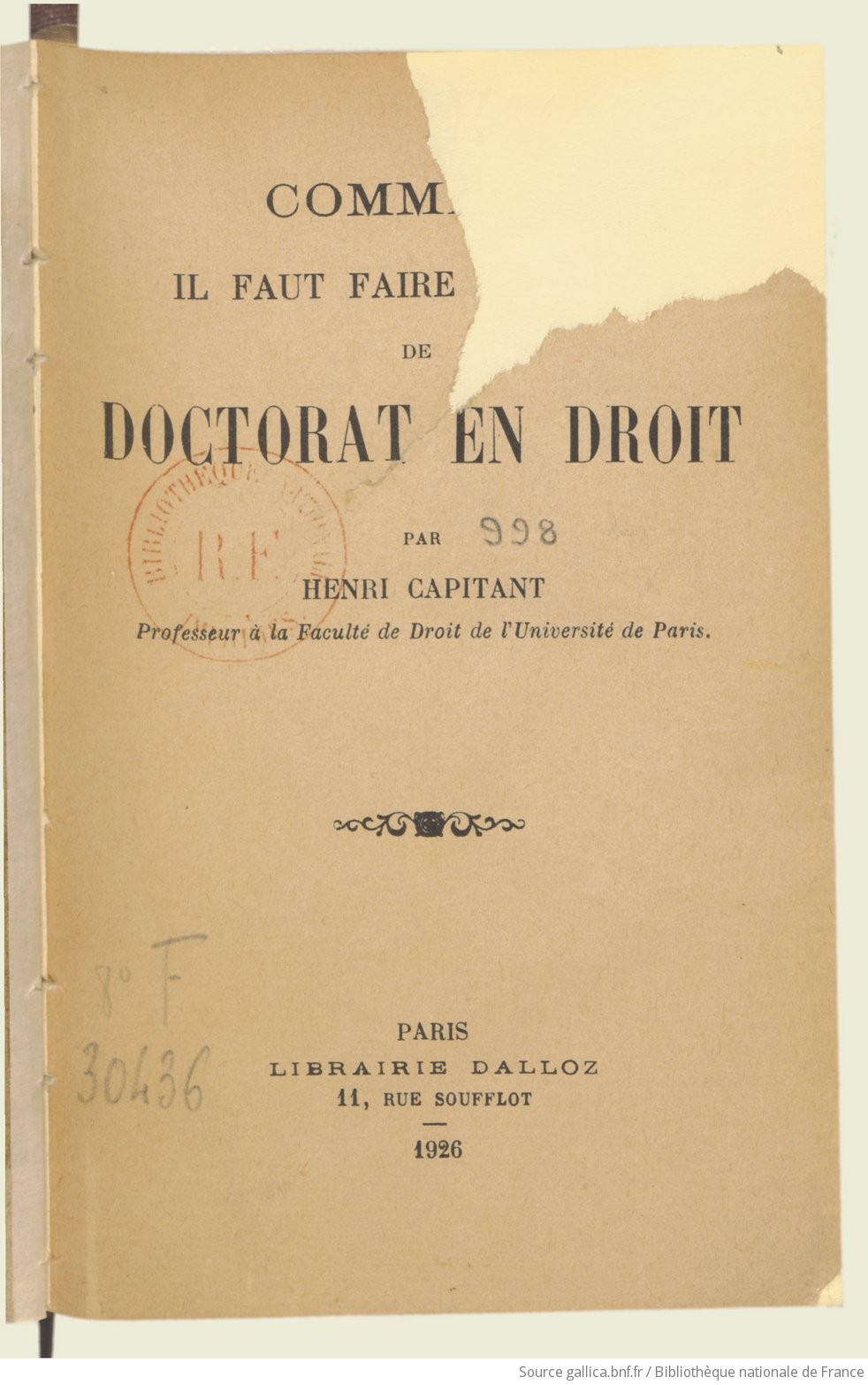
Le Choix du Sujet
Le choix du sujet est évidemment fondamental, tant le travail nécessite endurance et abnégation. Il doit donc :
- Être personnel ;
- Passionnant pour l’intéressé ;
- Equilibré entre les travaux qu’il nécessite et les aptitudes de l’étudiant.
« Les candidats au doctorat qui exercent déjà une profession, qu’ils travaillent dans une étude, une compagnie d’assurances, une banque ou une administration, ont intérêt à étudier une institution se rattachant à leurs occupations. Placés à la source des renseignements, ils pourront faire une œuvre bien documentée, et, par conséquent, intéressante, car une thèse ne vaut que ce que valent les documents qui ont servi à la composer. »
Autrement dit, la thèse doit apporter de la valeur scientifique à la recherche.
La proximité avec le sujet travaillé permet de disposer d’un accès privilégié à certaines sources5 et interprétation, mais également de bénéficier d’une certaine avance intellectuelle.
Les Recherches Bibliographiques
Il convient d’abord de distinguer :
- Les ouvrages généraux, qui proposent une vue panoramique sur différents sujets, des synthèses et des pistes, et
- Les ouvrages spécialisés : thèses, articles, notes publiées dans les recueils de jurisprudence… qui constituent l’essentiel des éléments qui vous permettront d’avancer plus avant dans la compréhension technique du sujet. Jusqu’au dépassement et à l’invention : la trouvaille du thésard6.
Le Plan
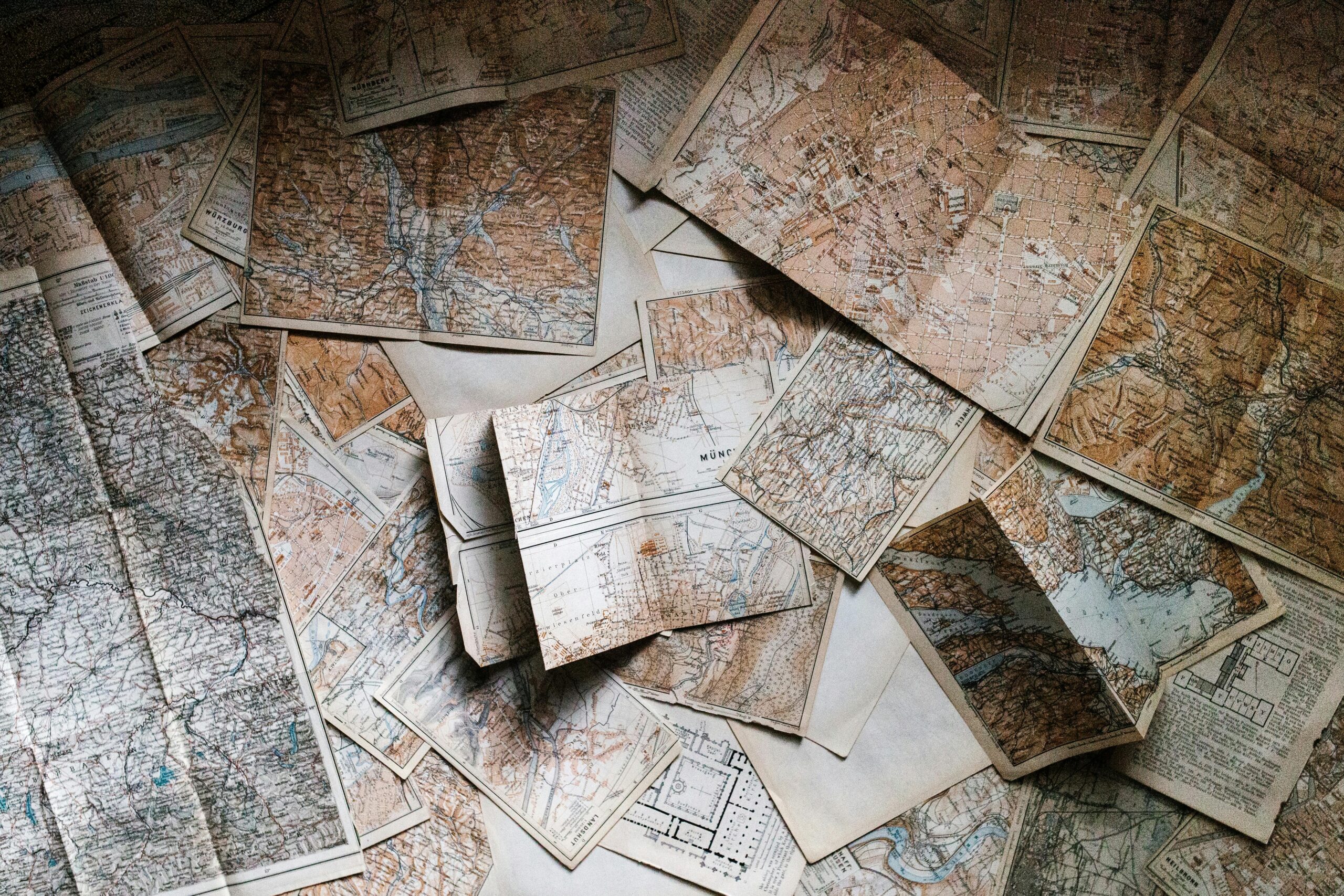
Le Plan Provisoire
La première élaboration du plan n’est évidemment pas définitive et évoluera au gré des recherches et des approfondissements. Toutefois, même provisoire, l’existence d’un plan est fondamental.
« Toutefois, l’auteur devra avoir soin de tracer au plus tôt un plan d’ensemble pour délimiter son sujet et préciser ses investigations. Pour cela, il prendra une vue générale de son sujet dans les travaux antérieurs qu’il lira rapidement en ne notant que les idées principales et les réflexions que lui suggère cette lecture, sans vouloir d’ores et déjà en retenir la substance et en extraire tous les renseignements qu’ils peuvent fournir. Ce qu’il faut, c’est acquérir le plus vite possible une vue d’ensemble de la matière et se fixer des points de repère pour les recherches qui vont suivre. L’étudiant tracera donc un plan provisoire pour se tracer des limites et éviter de se jeter dans des chemins de traverse. »
Le premier écueil consiste, en effet, à « glisser hors du sujet » au gré des lectures. Si le rapport n’est pas immédiatement visible entre la lecture d’un texte et le sujet étudié, il convient de noter quelques idées générales sur le sujet, les références (évidemment) et de passer outre.
Sur les divisions et subdivisions, le nombre d’entre elles dépend de la complexité du sujet, mais la structure classique est à privilégier :
- Partie,
- Titre, éventuellement,
- Chapitre (le plus souvent),
- Section,
- Paragraphe.
Chaque fiche de recherche est à rapporter aux divisions et subdivisions adoptées par l’étudiant.
Le Plan Définitif
« Le travail de recherches et la réflexion conduisent presque nécessairement à modifier le plan primitivement établi, à déplacer certaines matières, à changer l’ordre des chapitres, des sections, des paragraphes. Si nous recommandons la constante préoccupation du plan durant la période d’initiation au sujet, c’est pour que l’auteur serre de près le problème étudié, le creuse en s’y enfermant et évite d’être confus, mais il est bien évident qu’il doit apporter au plan d’abord tracé toutes les modifications que les recherches postérieures permettront de découvrir. »
Le plan doit sans cesse être remanié, « quoique avec prudence », afin de ne laisser le désordre dans aucun coin et de permettre une circulation des idées fluides au sein de l’ouvrage.
« Il faut avoir plutôt le souci de l’ordre que le respect d’un ordre une fois établi. »
Une fois le dossier assez nourri, il convient de reprendre les notes et de vérifier leur reprise au bon emplacement.
Lorsque le plan est abouti, les recherches terminées et les notes réparties, Henri Capitant préconise l’écriture proprement dite7 :
« Avant de se mettre à la rédaction, il faudra établir le plan définitif, détaillé, qui devra être rigoureusement agencé et dans lequel chaque développement aura sa place marquée. Cela est indispensable pour éviter les à-coups ; on écrira très facilement, si l’on n’a qu’à suivre point par point le plan arrêté, en utilisant les notes classées une dernière fois d’après l’ordre définitivement adopté. »
Une fois la rédaction du corps du texte terminée, il convient de rédiger l’introduction et la conclusion.
La Documentation
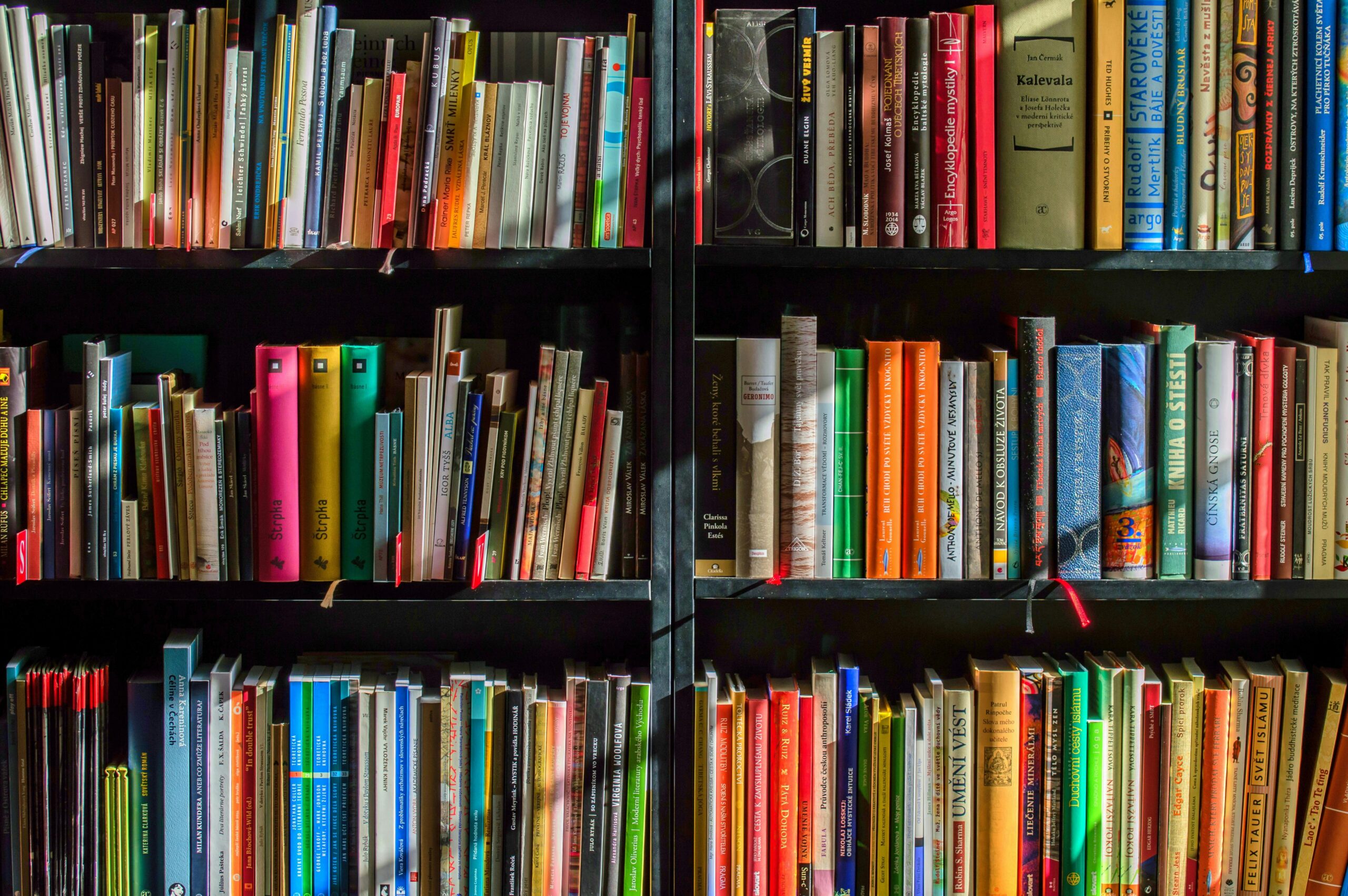
S’agissant d’une thèse juridique, l’étude historique n’est pas toujours nécessaire, l’étudiant devant s’en remettre à son directeur.
La principale source juridique pour le thésard demeure la jurisprudence8 :
« L’étude critique de la jurisprudence tient aujourd’hui une place considérable dans les œuvres de doctrine et dans les thèses de doctorat. Les décisions des tribunaux sont, en effet, pour le jurisconsulte ce que les phénomènes naturels sont pour le savant. »
C’est par la jurisprudence que le juriste peut relever l’évolution du droit, en constater la direction et émettre ses observations, formuler son jugement.
Par ailleurs, la jurisprudence permet également de saisir l’observation des faits en rapport avec la norme juridique étudiée.
La Rédaction
Une fois l’ensemble des recherches terminées, l’auteur dispose d’une vue d’ensemble de son projet.
« Quand il est bien maître de son sujet, il peut prendre la plume et rédiger. C’est la partie la plus difficile, la plus pénible du travail. C’est l’œuvre de production proprement dite. »
Il convient d’être court, concis, rigoureux et méthodique. Les citations ne doivent pas être trop longues.
« L’argumentation demande à être serrée, vigoureuse, pour frapper et convaincre le lecteur. »
L’ordre rigoureux est également nécessaire. Le développement de la pensée doit être fluide et conforme au plan établi, tout en étant précis :
« Disons encore que l’auteur doit apporter la plus grande précision dans toutes les citations qu’il fait. Qu’il s’agisse d’articles de loi, de décisions de jurisprudence, d’opinions d’auteurs. On doit toujours indiquer exactement l’article, et au besoin l’alinéa de l’article, le titre de l’ouvrage, son édition, le n°, la page citée, donner la date exacte des décisions en notant toujours la référence aux recueils. »
- Moi-même, je n’ai pas écrit ni n’écrit de thèse. ↩
- On pense évidemment au livre Comment écrire sa thèse de Umberto Eco ou encore, puisque ce blog est intitulé « Les Légistes » et s’intéresse d’abord au droit (en particulier public) : La thèse de doctorat et le mémoire de Simone Dreyfus et Laurence Nicolas-Vullierme. ↩
- L’âge d’or des juristes français, en droit privé comme public. ↩
- Dont ministre de la Justice. ↩
- Si l’utilisation de ces éléments est régulièrement autorisée, bien évidemment. ↩
- L’identification d’une problématique et une esquisse de solutions. ↩
- Ici, les avis divergent. Certains proposent d’écrire le plus rapidement possible, d’autres non. Il me semble qu’en l’espèce, il faut s’en remettre à ses penchants. Cependant, s’il s’agit d’une épreuve de dissertation ou d’une note de proposition, à l’évidence, l’écriture suit la validation définitive du plan. ↩
- Toute la construction intellectuelle du droit français semble reposer sur l’étude contentieuse. À cet égard, encore aujourd’hui, les commentaires d’arrêts occupent une place singulière. Cette étude jurisprudentielle du droit est évidemment étonnante pour la patrie du code. ↩
